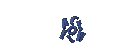Dans les communes rurales, la délimitation de propriété est la principale cause de conflits entre voisins. Il est très difficile d'y parer sans effectuer de bornage. Celui-ci consiste à déterminer la limite exacte de séparation entre deux propriétés contiguës, en la fixant par des marques apparentes: les bornes.
En cas d'entente entre voisins, il est toujours possible de faire soi-même ce bornage(mieux vaut alors le matérialiser par un acte écrit chez le notaire). Mais s'il y a conflit, il faut faire appel à une aide impartiale et qualifiée: un géomètre expert, qui se reportera à vos titres de propriété, aux éventuels plans, aux registres de cadastres communaux et préfectoraux et prendra des mesures exactes.
Si les deux parties acceptent ses conclusions, il dresse alors un procès verbal de bornage amiable, signé par celles-ci. Le document est alors déposé chez le notaire et publié à la conservation des hypothèques (coût du bornage: entre 700€ & 1500€, sans compter les frais de notaire et de publication, à répartir entre les parties).
En cas de désaccord sur l'opération de bornage, le partage des frais ou les conclusions de l'expert, vous pouvez vous adresser au Tribunal d'Instance. Les frais techniques de l'expertise demandée par le juge seront partagés ou imputés à l'une ou à l'autre des parties (possibilité d'appel des décisions du juge devant la Cour d'Appel).
A NOTER :
En cas de déplacement des bornes par un voisin, vous pouvez déposer une plainte contre X auprès du Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance.
Bruits, odeurs, dégradations ou morsures sont les principaux sujets de plaintes. En règle générale, un propriétaire est présumé responsable des dommages causés par son animal sur les personnes et les biens et se doit d'en supporter les conséquences financières.
Aussi est-il important lorsqu'on recueille un chat ou un chien chez soi, de s'assurer pour sa responsabilité civile (incluse souvent dans les contrats multirisques habitation). Pour autant, toute plainte de voisinage à ce sujet, n'est pas systématiquement justifiée ou recevable. En effet, l'appréciation des troubles et dommages varie selon les circonstances. Le chant du coq à cinq heures du matin est considéré comme normal à la campagne alors qu'il est réprimé en ville. Lorsqu'un chien renverse un cycliste, mord un enfant ou dégrade un jardin, son propriétaire est en revanche en faute, quelle que soit la situation géographique. Il peut être amené à verser des indemnités aux victimes et à appliquer certaines contraintes imposées par la décision d'un juge (enfermer ou attacher son chien, le faire vacciner contre la rage...). Dans ce genre de conflit, c'est généralement le Tribunal de Grande Instance (TGI) qui est compétent. Sauf cas particulier: en immeuble collectif par exemple, si vous retrouvez tous les matins les excréments du chien de votre voisin devant votre porte malgré une interdiction de promener son animal dans les parties communes de la copropriété (par règlement de copropriété), vous pouvez vous plaindre au syndic, qui a autorité pour agir auprès du propriétaire négligent. En revanche, aucun règlement ne pourra interdire à ce copropriétaire d'héberger un animal chez lui.
Il n'y a pas de mauvais chats ou chiens, il y a que de mauvais maîtres.

- Tout mur séparatif n'est pas mitoyen.
- La mitoyenneté ne concerne pas que les murs. D'autres sortes de clôtures, telles que haies ou fossés, peuvent aussi être mitoyennes.
Signifiant que l'objet dont elle relève, appartient aux deux propriétaires à la fois et non à chacun par moitié, la mitoyenneté les oblige à en jouir en commun et à gérer ensemble leur bien. Ce qui dans la pratique se révèle curieusement plus difficile que si chacun était propriétaire de son morceau de mur!
Important : un mur mitoyen ne doit pas être confondu avec une limite séparative. Car tout mur séparatif n'est pas forcément mitoyen. Selon la loi, en effet, n'est présumé mitoyen qu'un mur ou une clôture séparant deux bâtiments, deux cours, deux jardins, une cour et un jardin ou deux enclos dans les champs.
Un mur séparant un bâtiment et un jardin n'est pas présumé mitoyen, il appartient vraisemblablement au propriétaire du bâtiment. Un mur commun à deux bâtiments de hauteurs inégales, n'est présumé mitoyen que jusqu'à "l'héberge", c'est-à-dire la hauteur de la construction la moins élevée.
Dans ces cas la mitoyenneté est "présumée", mais peuvent exister des preuves contraires:
- Un titre de propriété qui affirme qu'un mur appartient en totalité à l'un des voisins;
- Des marques ou caractéristiques du type pente de la sommité du mur, chaperon, filet, ou corbeau d'un seul côté, indiquant que le mur appartient au propriétaire vers le terrain duquel le mur est en pente ou présente des signes.
- La prescription trentenaire selon laquelle un propriétaire qui exerce sa possession sur un mur (entretien, réparations, reconstruction) pendant trente ans sans réaction ni participation de l'autre, en devient propriétaire dans sa totalité.
De la mitoyenneté, découlent un certain nombre de règles et de contraintes de voisinage:
- Les frais sont partagés par moitié entre les deux propriétaires pour l'entretien ou la réparation;
- Un propriétaire ne peut créer une ouverture dans ce mur sans l'accord de l'autre. Il ne doit pas non plus l'abîmer (frais de réparation à sa seule charge), le démolir ou l'utiliser de façon préjudiciable pour son voisin (construire un ouvrage qui s'appuie dessus ou démolir un ouvrage sur lequel il s'appuie) ;
- S'il s'agit d'une haie ou d'un arbre, les coupes de bois ou récoltes de fruits doivent être partagées en deux.
Le propriétaire qui ne souhaiterait plus assumer toutes les conséquences de cette mitoyenneté, peut toujours l'abandonner (sauf dans certains cas) , par un acte notarié. Il n'aura alors plus rien à payer pour l'entretien ou la réparation de ce mur, mais son voisin deviendra alors le seul maître à bord.


Dans ce domaine, tout est question d'appréciation et de circonstances. Toutefois il existe des règles strictes. Depuis 1988 en effet, la notion de bruit a été réglementée par une loi qui établit des niveaux sonores à ne pas dépasser: 5 décibels le jour (entre 7 et 22 heures) et 3 la nuit, cette base étant augmentée de correctifs en fonction de la durée du bruit (avec par exemple une marge de +3 décibels si le bruit dure de 45mn à 2 heures).
Vos voisins sont donc tout à fait autorisés à faire du bruit la nuit, à condition de ne pas dépasser trois décibels (plus les correctifs). En revanche, ils n'ont pas le droit de faire du tapage après sept heures du matin, sous prétexte que c'est le jour (pas plus de 5 décibels plus correctifs).
En cas de conflit, vous pouvez vous adresser à un huissier (qui viendra constater le délit et mettre éventuellement le voisin en demeure de cesser son tapage), faire appel à la police ou la gendarmerie (qui pourra dresser un procès verbal). Dans certains cas, le maire, étant de par sa fonction chargé de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, pourra intervenir. Tout comme les services de la DDASS, si le voisin gênant est une entreprise.
LE DROIT DE PASSAGE

Au fil des successions, partages et remembrements, certains terrains se trouvent dépourvus de débouchés directs sur la voie publique. Leur propriétaire, pour y accéder, est obligé de passer chez les autres: c'est ce qu'on appelle le droit de passage. Une servitude courante, mais cause de nombreuses frictions.
Il est pourtant un principe de droit simple : chacun doit pouvoir accéder à son bien. Lorsqu'un terrain est enclavé, son propriétaire peut réclamer un passage suffisant (accès en voiture, en camion en cas de travaux, ou en tracteur pour un agriculteur) sur les terrains voisins.
Mais dans quelles conditions exactement ? C'est généralement là que les choses se compliquent entre les voisins, qui ne connaissent pas toujours les règles en vigueur.
Pour éviter les abus qui pourraient découler d'une telle situation, le législateur a créé des règles qui conditionnent ce droit :
- Lorsqu'un droit de passage grève une propriété, il se limite à une bande de terrain et non à la propriété dans son ensemble. Le tracé de ce passage est pris là où le chemin est le plus court pour relier le terrain enclavé à la voie publique et fixé dans l'endroit le moins dommageable possible. Une fois établi, ce tracé n'est plus modifiable
- Le propriétaire du terrain sur lequel s'établit ce droit, doit être indemnisé par le bénéficiaire sous la forme d'une somme forfaitaire, versée une fois pour toutes ;
- La servitude est attachée à la propriété et se transmet avec elle (avec les ventes, héritages ou donations), le notaire devant chaque fois la notifier aux acquéreurs ;
Pour que les choses soient bien claires, les voisins ont intérêt à matérialiser ce droit de passage par un acte notarié sur lequel ils inscriront les conditions d'exercice (tracé, participations aux frais d'entretien...).
A savoir : les travaux d'aménagement et d'entretien du passage sont à la charge exclusive du bénéficiaire, sauf si le propriétaire utilise également le passage.
Le droit de passage comprend aussi (si nécessaire) l'accès des canalisations et les liaisons aux réseaux courants (EDF, eau...). Enfin, si à la suite d'un remembrement, un nouvel accès est créé, désenclavant un terrain bénéficiant d'un droit de passage, ce dernier disparaît, même si les bénéficiaires le trouvent plus pratique. Et cela sans indemnité.
Si la victime est un locataire, elle peut aussi bien qu'un propriétaire engager des démarches et agir directement contre le voisin qui la gêne. Mais elle est aussi autorisée à manifester auprès de son bailleur qui, obligé par la loi de lui assurer "une jouissance paisible", se doit d'agir lui-même auprès de qui de droit.
C'est une charge qui pèse sur une propriété foncière pour l'usage et l'utilité d'une propriété voisine. Il peut s'agir d'un droit de passage, d'une servitude de vue sur la propriété du voisin, de l'obligation de laisser des ouvertures suffisantes pour l'écoulement des eaux de pluie depuis une propriété située à un niveau supérieur...
Liée à la propriété et non à la personne du propriétaire, une servitude se transmet avec les ventes, héritages et donations. Elle est donc perpétuelle sauf si d'elle-même appelée à disparaître (le droit de passage d'un terrain enclavé disparaît le jour où celui-ci est désenclavé à la suite d'un remembrement ou de la construction d'une nouvelle voie publique). Attention une servitude ne peut disparaître ci cette dernière est considérée comme Conventionnelle.
SERVITUDE CONVENTIONNELLE
CA Versailles, 25 mai 1992 : Juris-Data n° 042241:
L'existence, entre les propriétaires intéressés, d'une convention réglant l'assiette et les modalités d'exercice du passage ne modifie pas cette nature ; la servitude n'acquiert un caractère conventionnel que dans le cas où les accords conclus traduisent un souci particulier et circonstancié de desserte, conférant au maître des fonds dominant des droits excédant notamment par leur importance ou leur localisation, ceux que lui aurait ouverts son seul titre légal.
- les juges du fond apprécient souverainement le caractère constitutif et récognitif du titre (Cass. 3e civ.,16 juillet.1974: bull. civ III, n°310). Les arrêts rapportés ci-dessus confirment la portée pratique de la qualification. Celle-ci est liée à la suppression de la servitude en cas de cessation d'enclave, car <<on ne peut prononcer la suppression d'une servitude de droit de passage suite à la cessation d'enclave lorsqu'il s'agit d'une servitude conventionnelle>>
On ne le sait pas assez : passés trente ans, il n'est plus possible de remettre en cause une situation donnée et contre laquelle rien n'a été fait (un arbre situé près d'une limite séparative et dépassant les limites admises, une fenêtre ouverte sur un jardin et ne respectant pas les distances de vue imposées...).
De même une servitude non observée pendant trente ans peut disparaître (un droit de passage par exemple). Ainsi en décide la loi et plus particulièrement ce qu'on appelle la règle de prescription trentenaire.

Un arbuste inférieur à 2 m de hauteur doit être planté à une distance de 0,50 m de la limite séparative ;
Un arbre supérieur à 2 m sera installé à une distance de 2 m ;
Les propriétaires des arbres plantés à proximité d'une limite séparative ont obligation de couper les branches qui franchissent leur terrain. Sachez, aussi que :
Vous devez assumer les dégâts causés par un arbre vous appartenant, qui tombe chez le voisin ;
Les fruits d'une branche d'arbre appartenant à un voisin, même si celle-ci dépasse chez vous, ne vous appartiennent que lorsqu'ils sont tombés au sol ;
Si les feuilles mortes d'un arbre vous appartenant bouchent la gouttière de votre voisin, vous n'en êtes pas juridiquement responsable.
Important : certains usages locaux contredisent parfois les lois. Ne les négligez pas car ils ont généralement raison de celles-ci. Pour les connaître, adressez-vous à la mairie de votre commune ou à un notaire de votre région.
DES CONSTRUCTIONS SOUS SURVEILLANCE

Chacun est libre d'utiliser son terrain pour y construire, à condition de respecter les règles d'urbanisme, les réglementations locales (indiquées sur le Plan d'Occupation des Sols) et ses voisins. Si l'on construit près de chez eux, ceux-ci ont en effet un droit de regard sur les projets de construction. Tout permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, ils peuvent le contester sur des points précis qui les concernent. Comment ? En relevant le numéro affiché sur le chantier et en s'adressant à la mairie.
Si vous comptez, par exemple, construire une étable, un poulailler, une cheminée ou une fosse septique, sachez qu'il existe des distances à respecter par rapport aux habitations voisines.
En matière d'ouverture de fenêtres, prévoyez une distance de 1,90 mètre s'il s'agit d'une vue droite sur la propriété voisine et 0,60 m en cas de vue oblique. C'est à dire lorsqu'on regarde non pas en face de la fenêtre mais de côté. Si votre ouverture ne respecte pas ces distances, il est toujours possible d'installer un châssis fixe avec verre dormant (translucide et non transparent). En revanche, si votre indiscrétion a été tolérée par votre voisin pendant trente ans, il devra la supporter définitivement(règle de la prescription trentenaire).
Un jour de tolérance (qui ne peut s'ouvrir et ne laisse passer que la lumière, mais ni l'air ni le regard) doit aussi être garni d'un treillage de fer dont la maille atteint 10 cm d'ouverture au maximum et placé à 2,60 m de hauteur depuis le plancher de la pièce à éclairer, s'il s'agit d'un rez de chaussée et à 1,90 m en étage.